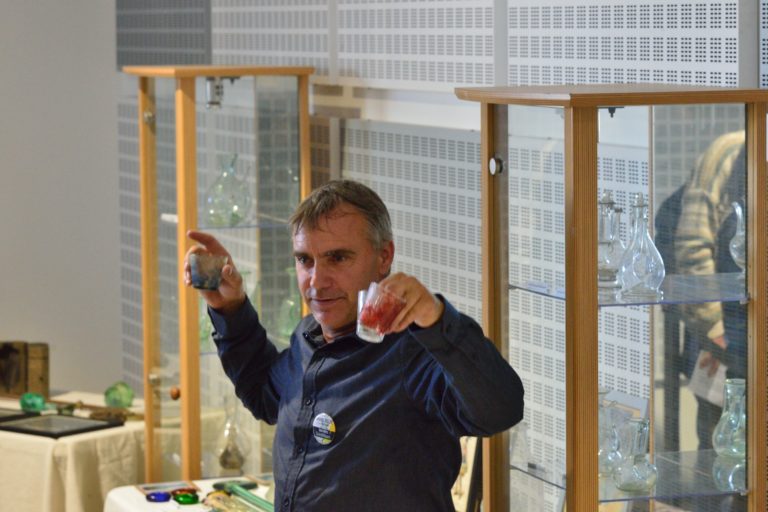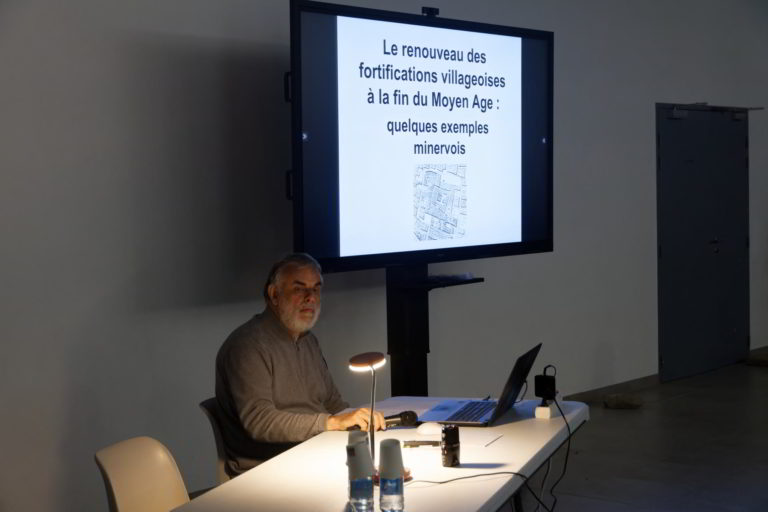Gauthier LANGLOIS
Professeur d’Histoire-Géographie,
Chercheur associé au laboratoire FRAMESPA
Université de Toulouse
CNRS1
Le sceau est un signe personnel d’authentification des actes qui, à partir du XIIe siècle, se développe progressivement dans toutes les couches de la société.
Pour les grandes villes puis les bourgs et villages nouvellement dotés d’un consulat ou administration municipale, il constitue l’un des signes de leur personnalité juridique. C’est aussi le support d’une identité figurée par une légende et une image.
Les études sur les sceaux urbains montrent que certains consulats manifestent leur dépendance vis-à-vis de l’autorité seigneuriale en reprenant ses armes, sa bannière ou son château. D’autres manifestent leur indépendance en figurant les consuls, l’enceinte urbaine ou le saint patron de la paroisse.
Qu’en est-il dans les bourgs et les villages aux sceaux peu étudiés et rarement conservés ?
Pour répondre, nous disposons d’un corpus de 85 sceaux consulaires languedociens conservés aux Archives nationales.
Ces sceaux sont appendus à des actes de soumission au roi suite à la croisade des Albigeois et à l’adhésion au procès de Boniface VIII en 1303.
Parmi eux, nous allons nous intéresser à 15 sceaux de localités de la Montagne-Noire. Leur étude montre que les plus petites communautés reprennent majoritairement des symboles de l’identité seigneuriale, signe d’une dépendance vis-à-vis du seigneur local, comme à Villemagne ou Saissac, ou d’une recherche de la protection royale comme à Peyriac-Minervois.
Un autre groupe fait usage d’armes parlantes, partagées avec la famille seigneuriale : une oule pour Olargues, des pommes pour La Pomarède…
Enfin, des bourgs choisissent des signes originaux, marqueurs d’une recherche d’autonomie par rapport au seigneur avec lequel ils sont souvent en conflit. C’est le cas de la communauté de Saint-Pons-de-Thomières qui entretient des rapports difficiles avec l’abbaye du même nom, seigneur du lieu. Son sceau arbore d’abord un emblème très aristocratique, un léopard, puis l’orme qui devait orner la place du marché et sous lequel les consuls devaient siéger.
En somme le sceau est pour la communauté l’expression de son identité, plus ou moins forte, et de son rapport avec l’autorité supérieure.

Crédit photos Christian Douillet
* Un livre de Gauthier Langlois : Dame Carcas, une légende épique occitane, SESA, 2023